
Je vous écris d'un jardin au cœur de Villeurbanne, parce qu'une gentille famille me laisse sa maison pendant huit jours en échange de quelques câlins à leur chat et quelques feuilles de salades données quotidiennement à leurs trois tortues. Alors me voilà ici, ailleurs, blottie dans une couverture polaire, pieds et mains glacées car mon sang ne circule pas normalement, sans doute le cœur qui est lassé de faire son travail. En venant, je me suis arrêté à la librairie en espérant trouver le dernier roman de Laurence Tardieu, j'ai terriblement besoin de mots qui sauvent ces derniers jours. Je n'ai pas la chance espérée, alors je me suis décidée pour Les années cerises, seul livre de Claudie Gallay que je n'ai pas encore lu. Et puis c'est un titre qui me ramène à mes plus belles années, mon enfance, aux souvenirs de tous ces jours où j'ai grimpé dans le cerisier du jardin, jusqu'à la cime, jusqu'aux nuages. Je ne savais pas encore, en ce temps-là, que l'innocence serait suivie de l'enfer. En sortant de la librairie, je me suis promenée dans les ruelles du centre-ville et il faisait bon, le soleil inespéré réchauffait ma peau blanche et j'ai marché sans but, sans autre but que celui de passer le temps. J'ai dans la tête les mélodies de Zaz, de cet album qui me touche et que j'écoute à répétition, cette phrase surtout, cette phrase qui dit : "Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur.". L'attente de cette rencontre qui me maintient en vie, l'attente de la revoir qui me tient debout, je compte les dodos jusqu'à ses mots. Les mots qui se mélangent et cette envie d'écrire que je ne peux satisfaire et qui me dévore, cette incohérence dans mes pensées et dans mes propos car mon cerveau semble tourner au ralenti, plus encore avec cette troisième mononucléose qui m'attaque, "la maladie du baiser", c'est romantique comme appellation, et pourtant. Je prépare la rentrée en pointillés, difficile de me projeter plus loin que le lendemain et pourtant, on attend tant de moi. Je confectionne des muffins aux fraises sans gluten, ils ont une drôle d'odeur, m'a dit ma sœur en riant, je coupe des abricots en petit dés pour nourriture les tortues, j'appose ma main sur leur carapace chauffée par le soleil, je souris en voyant des papillons. Je me dis qu'il reste encore des personnes gentilles, des âmes charitables, lorsqu'un homme m'aide à porter ma valise dans les escaliers et que je manque de m'effondrer, vrai parcours du combattant pour mon corps épuisé. Je collectionne les sourires, les regards, les mains tendues lorsqu'elles se présentent. Le froid me colle au corps, les discussions sont un peu tristes à la naissance du sommeil, mon corps collé contre le sien, brûlant. Commencer à écrire dans ce tout nouveau carnet, me concentrer pour garder en mémoire le rire de ma sœur. Voir Victor. Il me dit qu'il entend la mer dans un coquillage qu'il a trouvé dans le salon de cette maison qui n'est pas la mienne, et je lui répond que moi, je vois la mer dans ses yeux. Mais la mer un jour de tempête, j'ajoute. Un soir, nous prenons un bain. L'eau chaude coule dans mon dos, le clapotis me donne envie de dormir, soudain. On est assis imbriqués comme deux pièces d'un jeu de Tétris, je suis recroquevillée, la pudeur me ligote. J'avoue tout bas que j'ai peur de retourner à Grenoble, de ce que cela va me faire vivre à l’intérieur, mais je le sens loin de moi et je ne sais pas s'il m'écoute. Pendant que je lave mes cheveux, l'odeur du henné et de la noisette emplit l'air humide, il chantonne une chanson des Wriggles et je ris, et il répond à mon rire, et l'écho de nos rires reste longtemps suspendu dans le silence qui suit.
J'ai emprunté la route mille
fois parcourue, gravi les marches cent fois grimpées. Quand elle a ouvert la porte, j'ai lu l'étonnement sur son visage en me voyant assise là à triturer mes mains, l'espace d'une seconde, et puis
elle a souri. J'ai parlé, longtemps. Elle m'a écouté, beaucoup. Comme chaque fois, j'ai bu ses paroles et ses conseils étaient (une fois encore) si pertinents que je voudrais avoir un petit Jiminy
Cricket sur mon épaule qui me susurrerait ses mots à l'oreille dans les moments de doute. On parle de mes études et de cette année à venir qui s'annonce si éprouvante, de ma crainte du futur et de
mes envies d'ailleurs. On parle de Victor -un peu-, et de maman -beaucoup-, de la peur que j'ai qu'elle meure. Vous aussi, j'ai terriblement peur de vous perdre. Je l'ai pensé tout
bas et je n'ai rien dit. On parle de Laurence Tardieu, et quand je devine que le rendez-vous touche à sa fin, la tristesse fait couler mes larmes. Juste quelques unes, c'est peu comparé aux
petits lacs qui se sont formés derrière mes yeux depuis quelques semaine mais quand même, j'ai envie de pleurer plus fort et de tout faire sortir. C'est une drôle de sensation que d'être ivre de
tristesse : une fois que toutes les larmes sont évacuées et que les yeux brûlent, une immense fatigue m'envahit et je suis soulagée, enfin, de ce trop-plein de malheur. J'aurais envie de ça mais
j'essuie les perles sur mes joues d'un revers de bras, comme ça, l'air de rien. Elle sourit, on note le prochain rendez-vous. Je remarque (pour la deuxième fois depuis que je la connais) le tatouage
sur sa cheville. Toujours aussi mystérieux, ce petit symbole. Je me dis, on connait parfois si peu des gens auxquels on tient le plus. Elle entoure ma main froide des deux siennes, chaudes et
rassurantes. J'ai envie qu'elle me prenne dans ses bras, je mords ma lèvre et je réussis à articuler : Je ne pleure pas. Ma voix tremble et la porte se referme sur son visage. Chancelante, je
descends les escaliers en me répétant tout bas pour me convaincre : ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Je ne pleurerai pas. Déjà, j'ai l'impression d'avoir tout oublié des mots dont je
voulais tant me rappeler. Il y a cette citation, que j'ai cherchée pendant l'entretien et que je n'ai pas su retrouver, je ne sais pas dans quelle tiroir de ma mémoire elle était rangée et
heureusement, quelques pense-bêtes existent. Je pense (j'espère) qu'elle me lira, alors je crois qu'il n'est pas trop tard pour la partager. C'est une phrase de Philippe Delerm, issue de son roman
"L'écriture est une enfance".
« Garder l’esprit d’enfance n’est pas seulement un privilège. C’est aussi une blessure. Se rappeler toujours qu’on a vécu plus fort avant, c’est accepter d’emblée que la vie soit une défaite. »
Quand je vais là-bas, immanquablement, l'inspiration revient. Ce désir d'écrire, irrépressible, renait près de mon plexus. J'ai hâte d'acheter le nouveau roman de Laurence Tardieu et son dernier dans un même temps, de suivre sa vie lorsqu'elle a perdu le chemin des mots et de découvrir de quelle manière elle a retrouvé la lumière. Plus que tout, j'ai besoin de croire en une renaissance, j'ai besoin d'y croire encore.
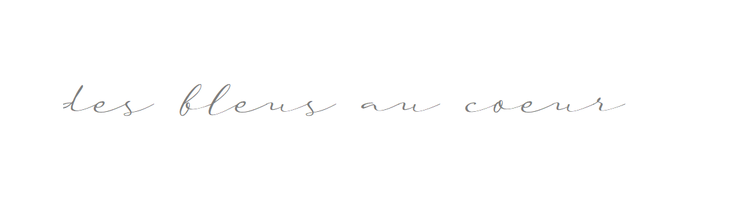
Écrire commentaire