
Aujourd'hui, je raconte. Le manque qui perfore le coeur certains jours lorsque j'y repense. Un an et demi de mon existence. Si peu et déjà loin. Et pourtant. Tout me ramène à cette periode-là, chaque chose de ma vie de maintenant, aussi infime et insignifiante puisse-t-elle paraître, aussi minuscule, chacun de mes faits et gestes, chacune de mes réactions. Chaque marche gravie, chaque manque, chaque douleur est comparée à ce que j'ai vécu là-bas. Tout : les personnes croisées, les parfums dans la rue, les livres lus, les chansons. Aujourd'hui, je raconte. Je raconte la clinique, ce que j'y ai vécu, les souvenirs qu'il m'en reste. Je ne lui parle pas -pas encore- du fait que ma vie d'aujourd'hui est entièrement conditionnée par celle d'hier, que je ne vis que dans le passé. Mais tout de même, et c'est un premier pas je crois, pour la toute première fois je lui raconte. Cette protection, ce filtre face au monde extérieur, ce cadre. Les repères qui désormais me manquent. Là bas, je n'étais jamais seule. Là bas, on prenait soin de moi. Les cris et les pleurs qui n'étaient pas toujours compris mais qui étaient entendus. Les discussions en tailleur dans les escaliers, l'horaire des médicaments. Les balades en chaussons dans les couloirs. La tournée des veilleurs du soir. Les discussions qui s'éternisent dans le parc à la lumière des lampadaires. Le petit-déjeuner pris tôt le matin avant de partir au centre aéré. La musique à tue-tête et la fenêtre ouverte les jours de soleil, les jours de sourire. Ils étaient rares mais ils existaient, les jours de sourires. Les réunions soignants/soignés. Le self et les repas aux discussions interminables, minables parfois, et les fou-rires, les carrés de poisson blancs et les yaourts natures, le tout bien structuré, rassurant. Les courses poursuites dans les escaliers. Le photolanguage. Les petits matins où je rejoignais No à pas de chat pour me glisser dans son lit. Les réunions cafés. Les pauses thés. Les petits-dejeuners pris avec Amandine devant les dessins animés. Les citations que j'inscrivais au feutre Véléda sur la fenêtre de la porte de ma chambre. Les pique-niques au parc Paul Mistral où nous imaginions le monde, en plus beau. Mes chaussettes en laines qui dépassaient de mes converses noires. Tous ces magazines que nous découpions pour faire des collages. Les sorties shopping avec mes deux parents, leur désir immense de me faire plaisir. La première autorisation de sortie après des semaines d'enfermement, la promenade avec No, la neige et les yeux qui pétillent. Et.
Là-bas, j'étais quelqu'un.
Je lui raconte. Ceux qui me manquent. J'ajoute : cela peut paraître étrange, mais ce n'est pas le vide le plus grand qui me fait le plus mal. Car le vide le plus grand ne l'est pas tout à fait, vide. La personne la plus importante est encore là. J'énumère. Marie, cette force qu'elle avait de toujours croire en moi. Daniela, son rire et les parties de Uno. Les infirmiers de nuits, qui étaient moins au courant de nos désastreuses trajectoires de vie et qui n'ont connu de moi pendant plusieurs mois que mon accaparant sommeil. Ces mêmes infirmiers qui, plus tard, m'ont fait rire et offert tant de bienveillance face aux envahissants et trop nombreux cauchemars. Allison, sa présence rassurante et ses paroles réconfortantes, sa douceur. Mme F pour qui j'ai toujours une grande affection malgré qu'elle ne m'ai pas toujours comprise : je garde d'elle son désir de bien faire et de m'aider. Je parle d'Orphée. De ce silence qui me hante depuis un an et demi. De cette tendresse que j'ai pour elle alors qu'on se connaît si peu. J'aurais pu parler de ceux qui sont toujours là ou ne le sont plus, de ces liens qui restent les plus forts, inoubliables, et devant lesquels je pleure parfois. Clémence, Amandine, No, Camille, Violette, Coralie, Darshan, Lisa, Amandine, Coralie, Marion, Dellel. Ce qui me manque. Cette facilité à entrer en lien. Il y avait, je ne sais pas, une sorte de reconnaissance entre toutes ces âmes à la dérive que nous étions, et ces sourires tristes qui voulaient tout dire. Ces mains tendues. Ce pardon qu'on m'accordait à être hors de la vie, à ne rien construire, à ne pas réussir à faire. Ce pardon qu'on m'octroyait à ne pas faire partie de ma propre vie, à ne pas pouvoir y être, ne pas vouloir peut-être aussi. Cet espace hors du temps que rien ne m'obliger à assumer, sinon à tenter de prendre soin de moi. Cette non-vie que l'on m'accordait.
Et puis, j'ai compris que ce cocon ne m'accueillerait pas éternellement.
On ne pouvait pas me protéger de tout.
Je lui dis : "Je suis nostalgique. Voilà. Cela ne semble peut-être pas avoir de sens pour vous, mais ça me manque. Et Noël qui approche, je veux dire, c'est une période qui rend ces choses-là encore plus douloureuses." J'ai serré mes mains l'une dans l'autre et j'ai baissé les yeux. C'était la petite fille qui venait de parler. D'avouer.





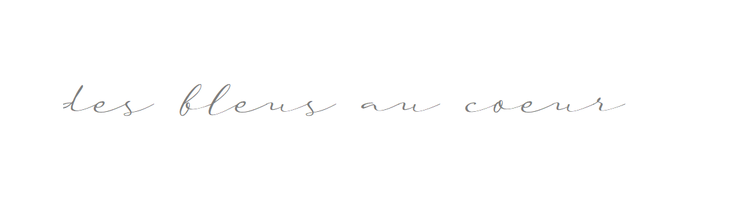
Écrire commentaire